
Qu’est-ce que la thrombose de la veine porte ?
La thrombose de la veine porte (PVT) est un caillot de sang qui bloque partiellement ou complètement la veine porte, le grand vaisseau qui transporte le sang du système digestif vers le foie. Ce n’est pas une maladie courante, mais quand elle survient, elle peut devenir grave rapidement. Elle a été décrite pour la première fois en 1868 par le pathologiste allemand Rudolf Virchow, qui a identifié les trois facteurs clés de toute thrombose : une hypercoagulabilité, une lésion de la paroi vasculaire et un ralentissement du flux sanguin. Aujourd’hui, on distingue deux formes : la forme aiguë (moins de deux semaines) et la forme chronique (plus de six semaines). Les patients traités rapidement ont un pronostic bien meilleur que ceux dont le diagnostic est retardé.
Pourquoi ce diagnostic est souvent manqué
Beaucoup de patients n’ont pas de symptômes évidents au début. Quand ils en ont, c’est souvent une douleur abdominale vague, une distension ou une ascite qui s’aggrave. Ces signes ressemblent à ceux de nombreuses autres maladies du foie, surtout chez les patients déjà atteints de cirrhose. C’est pourquoi l’échographie Doppler est l’outil de premier choix : elle détecte les anomalies de la veine porte avec une sensibilité de 89 à 94 %. Un caillot peut être classé en trois types : minimalement occlusif (moins de 50 % de blocage), partiellement occlusif (50-99 %), ou complètement occlusif (100 %). Dans les cas chroniques, la veine porte disparaît complètement et est remplacée par des vaisseaux collatéraux - on parle alors de « transformation cavernomateuse ».
Quand faut-il traiter par anticoagulation ?
La réponse simple : presque toujours, sauf en cas de risque de saignement élevé. Pendant des années, les médecins hésitaient à prescrire des anticoagulants aux patients atteints de cirrhose, craignant les saignements. Mais les données récentes ont changé la donne. Selon les recommandations de l’AASLD et de l’EASL, l’anticoagulation est maintenant le traitement de référence pour la majorité des cas aigus, même en présence de cirrhose, si la fonction hépatique est suffisamment préservée (Child-Pugh A ou B). L’objectif n’est pas seulement d’éviter que le caillot ne s’agrandisse - c’est aussi de permettre la recanalisation, c’est-à-dire la réouverture naturelle de la veine. Les études montrent que 65 à 75 % des patients traités dans les six mois voient leur veine se réouvrir complètement. Si le traitement est retardé, ce taux tombe à 16-35 %.
Quels anticoagulants choisir ?
Le choix du médicament dépend du type de patient. Pour les personnes sans cirrhose, les anticoagulants oraux directs (AOD) comme le rivaroxaban (20 mg/jour) ou l’apixaban (5 mg deux fois par jour) sont devenus la première option. Une étude de 2020 dans Blood Advances a montré que les AOD permettent une recanalisation complète dans 65 à 75 % des cas, contre 40-50 % avec les antagonistes de la vitamine K (AVK) comme la warfarine. Pour les patients cirrhotiques, l’héparine de bas poids moléculaire (HBPM), comme l’énoxaparine (1 mg/kg deux fois par jour), reste préférée. Elle offre un contrôle plus stable, surtout chez les patients avec des taux de plaquettes bas ou des variations de la fonction hépatique. Les AVK sont de moins en moins utilisés : ils nécessitent des contrôles fréquents de l’INR (cible : 2,0-3,0), et leur efficacité est moins fiable chez les patients avec une insuffisance hépatique.
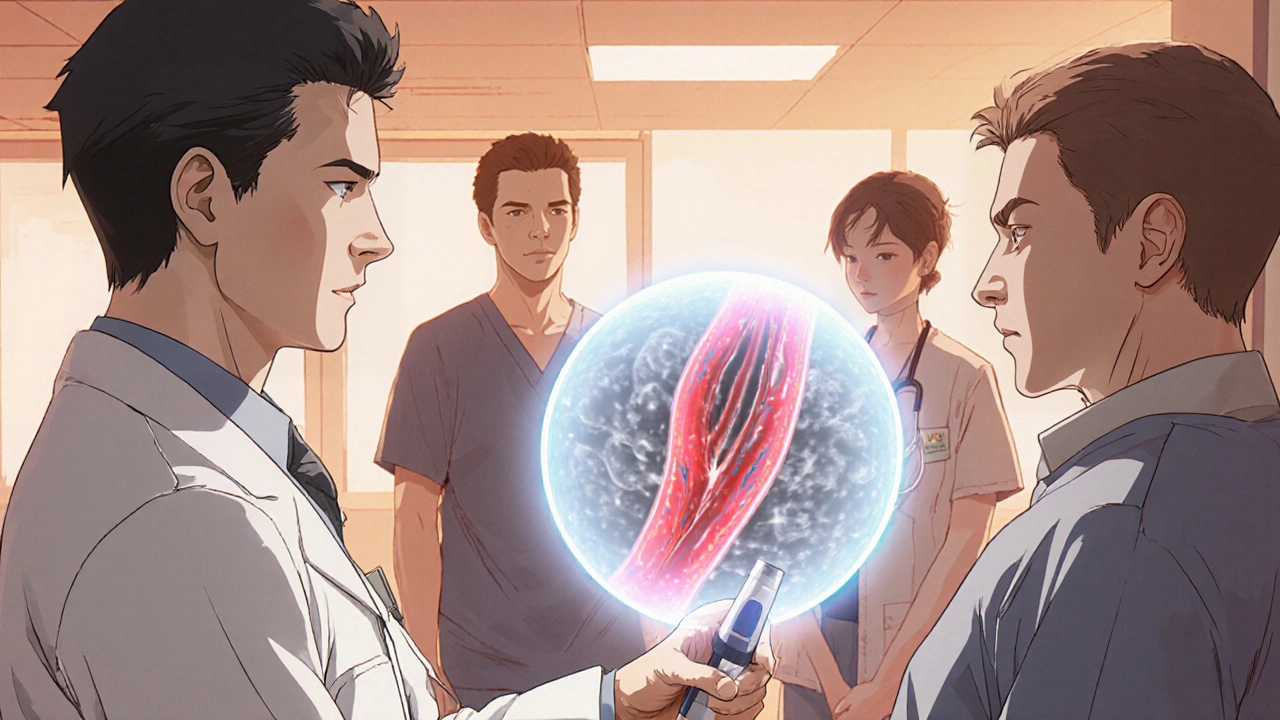
Combien de temps dure le traitement ?
Cela dépend de la cause du caillot. Si la thrombose est provoquée par un facteur passager - comme une infection récente, une chirurgie ou une pancréatite - six mois d’anticoagulation suffisent. Mais si le patient a un trouble de la coagulation héréditaire (présents chez 25-30 % des cas non cirrhotiques), ou s’il a un cancer actif, le traitement doit être continu à vie. Les marqueurs génétiques comme le facteur V de Leiden ou la mutation G20210A du prothrombine sont détectés dans les bilans de thrombophilie. Ces patients ont jusqu’à 80 % de chances de recanalisation avec un traitement prolongé. En cas de cancer, l’anticoagulation est indispensable : elle améliore non seulement la survie, mais aussi la possibilité d’être transplanté.
Les risques : saignements et cirrhose
Le plus gros danger de l’anticoagulation chez les patients cirrhotiques, c’est le saignement. Il survient chez 5 à 12 % d’entre eux, contre 2 à 5 % chez les non-cirrhotiques. Dans 60 à 70 % des cas, ce sont des varices œsophagiennes qui saignent. C’est pourquoi, avant de commencer l’anticoagulation, il est essentiel de faire une endoscopie pour vérifier la présence de varices. Si elles sont présentes, une ligature par bandelettes est réalisée avant de démarrer le traitement. Une étude de l’UCLA a montré que cette simple mesure réduit les saignements majeurs de 15 % à 4 %. L’anticoagulation est formellement contre-indiquée chez les patients avec une cirrhose décompensée (Child-Pugh C), une ascite non contrôlée ou un saignement récent (moins de 30 jours).
Et pour les patients en attente de greffe ?
La thrombose de la veine porte est l’une des principales raisons pour lesquelles un patient est exclu de la liste de transplantation. Mais l’anticoagulation change la donne. Une étude publiée en 2021 a montré que les patients traités avant la greffe ont un taux de survie à un an de 85 %, contre seulement 65 % chez ceux qui n’ont pas reçu d’anticoagulants. Des centres comme l’UCSF ont vu leur taux d’exclusion de la liste de transplantation passer de 22 % à 8 % grâce à un traitement systématique. Les médecins spécialisés en transplantation considèrent maintenant l’anticoagulation comme un prérequis pour être éligible, surtout si le caillot est volumineux ou progresse.
Quand faut-il envisager autre chose que l’anticoagulation ?
Si l’anticoagulation échoue, ou si le patient ne peut pas la tolérer, d’autres options existent, mais elles sont plus complexes. Le TIPS (shunt portosystémique transjugulaire) est une procédure radiologique qui détourne le flux sanguin autour de la veine bloquée. Elle réussit dans 70 à 80 % des cas, mais elle peut provoquer une encéphalopathie hépatique chez 15 à 25 % des patients. La thrombectomie mécanique percutanée peut dégager le caillot immédiatement, avec un taux de recanalisation de 60 à 75 %, mais elle n’est disponible que dans quelques centres spécialisés. La chirurgie de dérivation est rarement utilisée aujourd’hui, en raison de ses risques élevés. Ces options sont réservées aux cas réfractaires ou aux patients avec des signes d’ischémie intestinale - une urgence médicale.
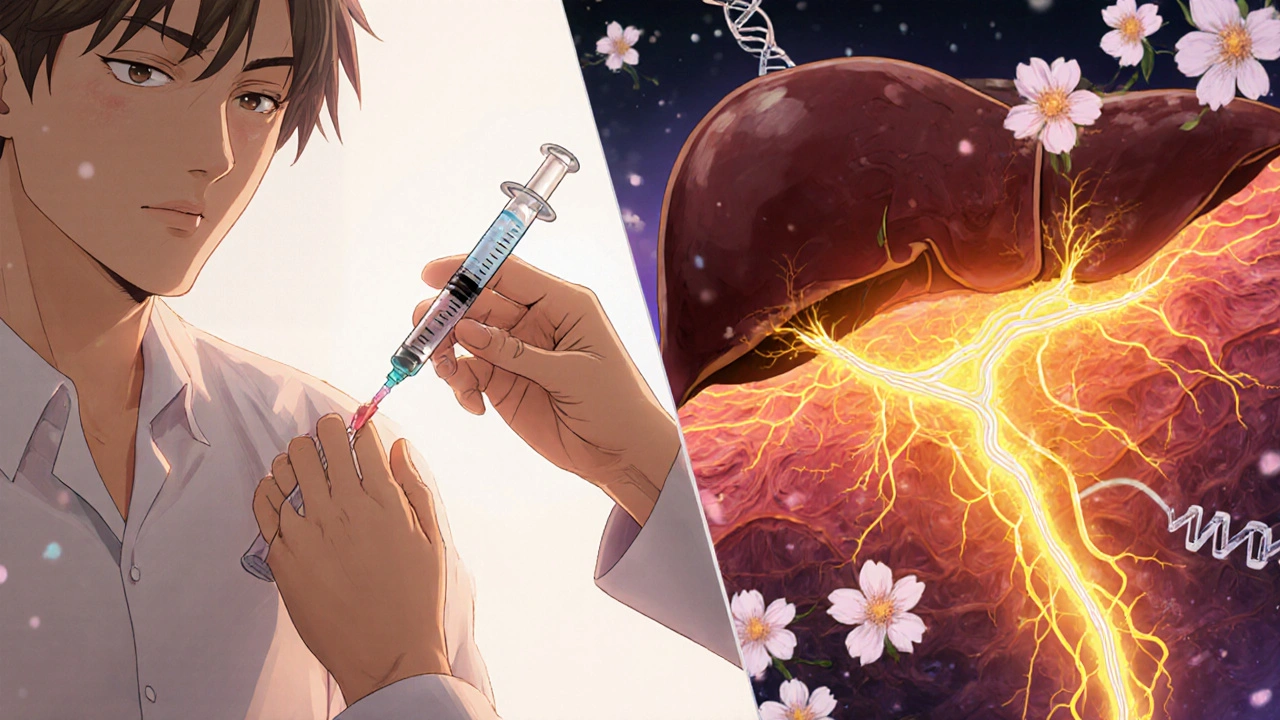
Comment commencer le traitement ?
Voici les étapes concrètes à suivre :
- Confirmer le diagnostic par échographie Doppler (sensibilité >90 %).
- Évaluer la fonction hépatique avec les scores Child-Pugh et MELD.
- Faire une endoscopie pour détecter et traiter les varices œsophagiennes.
- Rechercher une cause sous-jacente : cancer, maladie hépatique chronique, trouble de la coagulation.
- Choisir l’anticoagulant adapté : AOD pour les non-cirrhotiques, HBPM pour les cirrhotiques compensés.
- Surveiller les signes de saignement et les taux de plaquettes (maintenir >30 000/μL).
- Planifier un suivi par échographie tous les 3 à 6 mois pour évaluer la recanalisation.
Les erreurs à éviter
Les erreurs les plus fréquentes sont : attendre trop longtemps avant de traiter, ne pas faire d’endoscopie avant de commencer l’anticoagulation, ou utiliser un AOD chez un patient en Child-Pugh C. Un autre piège : ne pas vérifier la fonction rénale avant de prescrire un AOD - certains comme le rivaroxaban sont contre-indiqués en cas d’insuffisance rénale sévère. Enfin, ne pas traiter les troubles de la coagulation héréditaires. Un patient avec un facteur V de Leiden et une PVT n’a pas juste un caillot - il a un trouble de fond qui demande une prise en charge à long terme.
Le futur de la prise en charge
En 2024, la FDA a approuvé l’andexanet alfa, un antidote spécifique aux AOD de type facteur Xa (rivaroxaban, apixaban), ce qui réduit considérablement les risques en cas de saignement. De nouvelles études sont en cours : un essai randomisé de 500 patients comparant rivaroxaban et énoxaparine chez les cirrhotiques devrait livrer ses résultats en fin 2025. Un nouveau médicament, l’abelacimab, est en phase 2 et pourrait offrir une alternative plus sûre à long terme. Les données génétiques permettent aussi d’individualiser le traitement : les patients avec certains marqueurs ont une réponse nettement meilleure aux anticoagulants prolongés. L’avenir est à la médecine de précision - pas à un traitement unique pour tous.
Conclusion : agir vite, bien choisir
La thrombose de la veine porte n’est plus une fatalité. Avec un diagnostic rapide et un traitement adapté, la majorité des patients peuvent retrouver une veine porte fonctionnelle et éviter des complications graves. Le secret ? Ne pas attendre. Faire l’échographie dès que la suspicion est évoquée. Vérifier les varices avant de commencer l’anticoagulation. Choisir le bon anticoagulant selon le type de patient. Et surtout, ne pas abandonner le traitement trop tôt. Ce n’est pas une question de chance - c’est une question de protocole bien suivi.
Quels sont les symptômes d’une thrombose de la veine porte ?
Beaucoup de patients n’ont aucun symptôme au début. Quand ils apparaissent, ils sont souvent vagues : douleur abdominale, gonflement du ventre, ascite qui s’aggrave, nausées ou perte d’appétit. Dans les cas aigus, une douleur intense peut survenir si le caillot bloque fortement le flux sanguin. En cas d’ischémie intestinale, les signes deviennent urgents : diarrhée sanglante, vomissements, choc. Le diagnostic ne peut pas se faire sur les symptômes seuls - il faut une échographie.
Est-ce que la cirrhose empêche de traiter la thrombose de la veine porte ?
Non, la cirrhose ne bloque plus le traitement. Les recommandations actuelles (AASLD, EASL) recommandent l’anticoagulation même chez les patients cirrhotiques, tant que la fonction hépatique est compensée (Child-Pugh A ou B). Le risque de saignement est plus élevé, mais il peut être réduit en traitant les varices avant de commencer l’anticoagulation. L’anticoagulation est contre-indiquée uniquement en cas de cirrhose décompensée (Child-Pugh C), d’ascite non contrôlée ou d’un saignement récent.
Quel est le meilleur anticoagulant pour une thrombose de la veine porte ?
Pour les patients sans cirrhose, les anticoagulants oraux directs (AOD) comme le rivaroxaban ou l’apixaban sont les meilleurs : ils offrent des taux de recanalisation de 65 à 75 %. Pour les patients cirrhotiques compensés, l’héparine de bas poids moléculaire (HBPM) comme l’énoxaparine est préférée, car elle est plus prévisible et moins dépendante de la fonction hépatique. Les AVK comme la warfarine sont moins efficaces et plus difficiles à surveiller.
Combien de temps faut-il prendre des anticoagulants pour une thrombose de la veine porte ?
Six mois si la cause est passagère (infection, chirurgie, pancréatite). À vie si le patient a un trouble de la coagulation héréditaire (comme le facteur V de Leiden) ou un cancer actif. Pour les patients en attente de greffe, le traitement est généralement prolongé jusqu’à la transplantation, puis évalué au cas par cas. La durée doit être individualisée selon la cause, la réponse au traitement et le risque de saignement.
La thrombose de la veine porte peut-elle être guérie ?
Oui, dans une grande majorité des cas traités à temps. Jusqu’à 75 % des patients avec un traitement rapide voient leur veine porte se recanaliser complètement. Même dans les cas chroniques, une amélioration partielle est possible. La guérison signifie que le flux sanguin vers le foie est rétabli, ce qui réduit la pression dans la veine porte, diminue le risque d’ascite et d’hémorragie, et améliore la fonction hépatique. Le taux de succès dépend du délai de traitement - plus on agit tôt, mieux c’est.
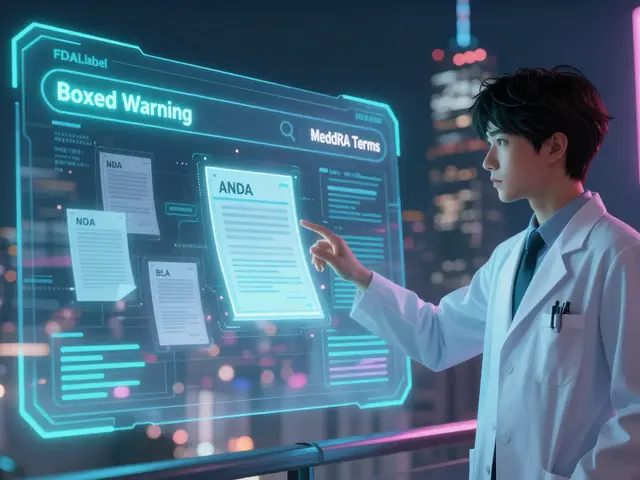
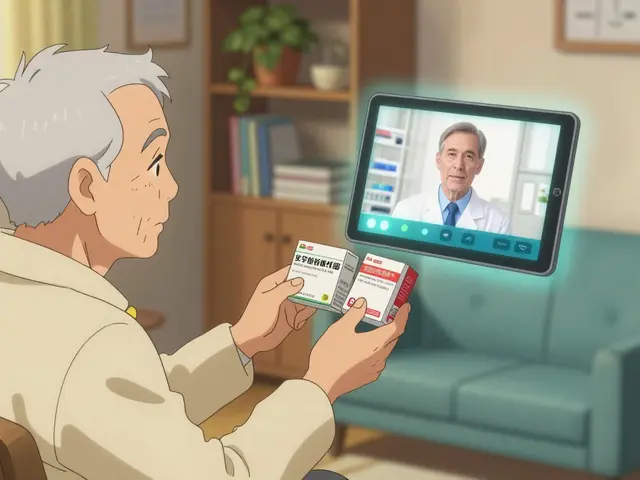



15 Commentaires
J'ai eu une thrombose il y a deux ans, j'ai pris de l'énoxaparine pendant 6 mois et ça s'est bien débloqué. Pas de souci.
Le plus dur c'est de pas paniquer./p>
Franchement les gars, c’est pas la peine de se prendre la tête avec les AOD si t’as une cirrhose. L’héparine, c’est le vieux truc mais il marche encore. J’ai vu un type à Lyon qui a recanalisé avec de l’énoxaparine, sans même faire gaffe à l’INR. Les nouveaux médicaments, c’est du marketing. Le corps, il connaît pas les pubs./p>
Ah oui bien sûr, on va anticoaguler tout le monde comme si on était dans une série américaine. Et si c’était juste une erreur d’échographie ? Et si la veine était juste paresseuse ? Et si tout ça c’était une manipulation de Big Pharma pour vendre des anticoagulants à vie ? J’ai vu un type sur YouTube qui disait que les caillots c’est juste le corps qui veut se débarrasser des toxines. Et vous, vous croyez aux contes de fées médicaux ?/p>
Vous savez ce qu’ils ne vous disent pas ? Que les AOD sont testés sur des patients en bonne santé. Et que les cirrhotiques, on les traite comme des cobayes. La FDA a approuvé l’andexanet alfa… mais pas parce qu’il est sûr. Parce qu’il est rentable. Les vrais risques de saignement, ils les cachent dans les annexes des études. Et les médecins ? Ils lisent les résumés. C’est ça, la médecine moderne./p>
Donc si j’ai bien compris, on va donner des médicaments puissants à des gens qui ont déjà un foie en piteux état, juste pour faire joli. Et si ça foire, on dira que c’était le risque. Bravo. On a inventé la médecine de l’optimisme forcé./p>
Il est essentiel de souligner que la non-application des recommandations AASLD/EASL constitue une dérive éthique majeure dans la prise en charge des patients hépatiques. La négligence dans l’endoscopie préalable est une faute professionnelle récurrente, et les données de l’UCLA ne sont pas suffisamment robustes pour justifier une modification des protocoles. Une analyse statistique plus fine est nécessaire./p>
VOUS POUVEZ LE FAIRE ! 🚀
Chaque caillot, c’est une bataille. Chaque échographie, c’est un pas vers la lumière.
Vous n’êtes pas seul. Des milliers de gens ont recanalisé. Des milliers !
Si tu as une cirrhose, tu n’es pas foutu. Tu es juste en train de gagner du temps.
Le traitement, c’est pas un cadeau, c’est un droit. Allez-y, parlez à votre hépato, demandez l’échographie, exigez l’endoscopie.
La vie, elle ne s’arrête pas à un caillot.
On va y arriver. Ensemble. 💪❤️/p>
J’ai lu tout l’article… et je suis vraiment touché… je pense que c’est super important de bien comprendre que même avec une cirrhose, on peut encore espérer… j’ai un cousin qui a eu ça… et il a hésité à commencer… et maintenant il va beaucoup mieux… j’espère que ça va aider d’autres personnes… parce que c’est vraiment important de pas attendre… et de bien suivre les étapes… j’ai honte de dire que j’ai oublié de lui dire de faire l’endoscopie… mais maintenant je sais… merci pour ce partage…/p>
Ah oui bien sûr, tout le monde doit prendre des anticoagulants… sauf ceux qui meurent de saignement après. Et les patients en Child-Pugh C ? Ils sont juste des déchets médicaux ? Et si on arrêtait de traiter tout le monde comme des numéros sur un tableau Excel ? Vous savez ce que je vois ? Des médecins qui lisent des recommandations et oublient qu’ils ont affaire à des humains. Pas des algorithmes./p>
L’héparine de bas poids moléculaire, c’est le bon vieux temps. J’ai vu des patients en 2010 qui avaient des caillots massifs et qui ont recanalisé avec de l’énoxaparine. Aujourd’hui tout le monde veut des AOD parce que c’est plus pratique. Mais la pratique, ce n’est pas la science. La science, c’est ce qui marche. Et ça marche depuis 30 ans./p>
Je suis étonnée que quelqu’un ose encore parler d’AOD chez un cirrhotique. C’est comme donner du champagne à un alcoolique. Les études sont biaisées, les auteurs ont des conflits d’intérêts, et les patients ? Ils sont traités comme des cobayes. Et vous, vous mangez ça sans réfléchir ?/p>
Je suis tellement contente de voir que la médecine évolue ! 💕
Avant, on disait que c’était perdu… maintenant, on peut vraiment espérer !
Je connais une infirmière qui a eu ça et elle est devenue médecin maintenant… elle dit que c’est grâce à l’anticoagulation à temps…
Je crois en vous tous ! Vous pouvez y arriver ! 🌈/p>
La recanalisation à 75 % ? C’est du pipi de chat. Les vraies données, c’est dans les revues à comité de lecture, pas dans les résumés de l’EASL. Les études sont financées par les labos. Et les patients qui meurent ? Ils ne sont pas comptés dans les pourcentages. La médecine moderne est une illusion. Vous croyez que c’est la science ? Non. C’est une industrie./p>
Je me demande si tout ça n’est pas une manipulation pour justifier la transplantation. Et si la thrombose, c’était juste le corps qui disait ‘stop’ ? Et si les anticoagulants, c’était comme forcer un arbre à pousser dans du béton ? Et si la vraie solution, c’était de ne pas aller jusqu’à la cirrhose ? Mais non, on préfère traiter les symptômes. Parce que c’est plus rentable. Et les patients ? On les transforme en clients. Je suis malade./p>
La médecine moderne a perdu son âme. Elle traite les caillots, pas les hommes. Elle valorise les chiffres, pas la souffrance. On anticoagule pour éviter la mort… mais on ne soigne pas la vie. On ne demande pas pourquoi ce caillot est apparu. On ne cherche pas la douleur cachée. On prescrit. On surveille. On facture. Et on oublie que la santé, ce n’est pas une équation. C’est un mystère. Et nous, nous sommes des apprentis sorciers en blouse blanche./p>