
Comment les pays décident du prix des médicaments génériques ?
Vous avez peut-être remarqué que certains médicaments génériques coûtent presque rien dans certains pays, tandis que dans d’autres, ils restent chers. Pourquoi ? La réponse ne se trouve pas dans la qualité du produit, mais dans une méthode cachée utilisée par les gouvernements : le prix de référence internationale. Cette pratique, courante en Europe, permet aux pays de fixer les prix des génériques en se basant sur ce que les autres nations paient. C’est un outil puissant pour réduire les dépenses de santé - mais il a aussi des effets secondaires souvent ignorés.
Comment ça marche ?
Le prix de référence internationale (PRI) fonctionne comme un système de comparaison. Un pays, disons la France, regarde les prix de certains médicaments génériques dans d’autres pays - généralement entre 5 et 7 pays voisins comme l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ensuite, il calcule la moyenne ou la médiane de ces prix. Le prix de remboursement pour le même médicament en France est alors fixé à ce niveau, ou légèrement en dessous.
Contrairement aux médicaments brevetés, où les prix sont souvent négociés individuellement, les génériques sont traités en groupes. On appelle ça le prix de référence interne. Par exemple, si 10 médicaments contenant le même principe actif (comme l’atorvastatine) sont vendus en France, le gouvernement désigne le moins cher comme référence. Tous les autres doivent se situer à ce prix ou moins pour être remboursés. Les fabricants sont alors obligés de baisser leur prix - ou de sortir du marché.
Quels pays le font, et comment ?
En Europe, 28 des 32 pays utilisent le PRI pour les génériques. Mais chaque pays le fait à sa manière. En Allemagne, depuis 2011, le système AMNOG fixe le prix de remboursement au plus bas prix du groupe, avec une petite marge de 3 %. En Hollande, les prix sont déterminés par des appels d’offres publics : les fabricants soumissionnent, et le plus bas gagne. Le résultat ? Les génériques y coûtent 65 à 85 % moins cher que les médicaments d’origine.
En Suisse, c’est plus complexe : le prix de référence est une combinaison de deux tiers de la moyenne internationale et d’un tiers basé sur les prix locaux. En Grèce, pendant la crise financière, les prix étaient révisés chaque trimestre - une mesure drastique pour faire face à la pression budgétaire. En revanche, les États-Unis n’utilisent pas le PRI au niveau fédéral. Seuls quelques États, comme le Colorado, l’appliquent pour les génériques du Medicaid, avec des économies de 12 à 15 %.
Les avantages : moins cher, plus d’accès
Le PRI a un impact direct sur les coûts. Selon l’OCDE, les pays qui l’utilisent pour les génériques voient leurs prix réduits de 25 à 40 % par rapport à ceux qui n’en font pas usage. En Espagne, le taux de substitution des génériques est passé de 52 % en 2010 à 89 % aujourd’hui. Cela signifie que les patients reçoivent des médicaments équivalents à un prix beaucoup plus bas - et les systèmes de santé économisent des milliards.
En Allemagne, le système a réduit la charge administrative pour les hôpitaux de 37 %. En France, la nouvelle version « dynamique » introduite en 2023 ajuste les prix chaque trimestre en fonction de la part de marché. Les premiers résultats montrent 8,2 % d’économies supplémentaires.
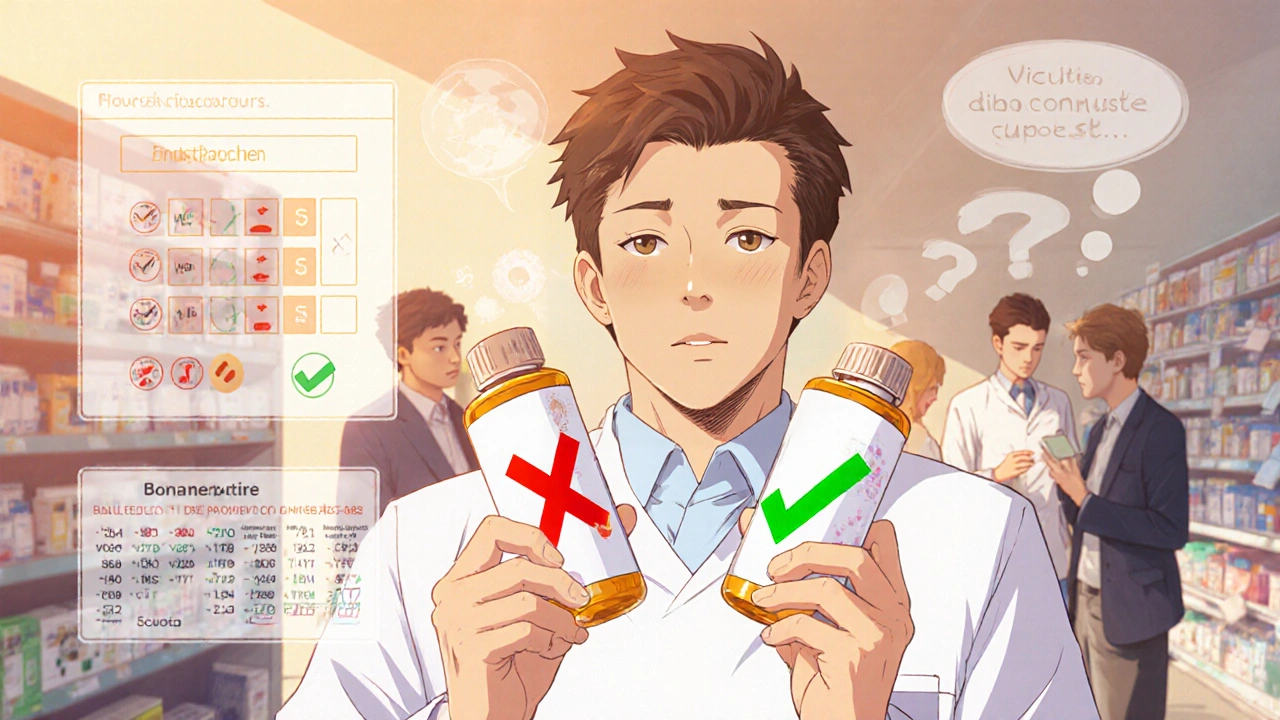
Les inconvénients : pénuries, qualité, et fuite des fabricants
Mais ce système n’est pas sans risques. Quand les prix sont fixés trop bas, les fabricants cessent de produire. En Grèce, entre 2012 et 2015, 37 % des génériques ont connu des ruptures de stock. En Portugal, 22 produits ont été retirés du marché en 2019 parce que les prix étaient devenus insoutenables.
Les patients eux-mêmes en ressentent les effets. Une enquête de 2017 en Grèce a révélé que 41 % des répondants avaient eu du mal à obtenir un médicament spécifique - parce que la pharmacie ne pouvait fournir que le générique le moins cher, même s’il n’était pas disponible.
Les fabricants de génériques, comme Teva et Sandoz, ont vu leurs revenus baisser en Europe malgré une augmentation des volumes. Teva a perdu 9 % de ses revenus dans sa division génériques, même si les ventes ont augmenté de 15 %. Pourquoi ? Parce que les marges sont écrasées. Certains fabricants ont cessé de produire des génériques complexes - comme ceux pour le cancer ou les maladies rares - parce que leur coût de développement approche celui des médicaments brevetés, mais qu’ils sont traités comme des produits ordinaires.
Le piège de la « spirale de prix »
Un problème majeur est ce qu’on appelle la « spirale de prix ». Quand un pays baisse ses prix, les autres le suivent. Si la France baisse le prix d’un générique, l’Allemagne le fait aussi. Puis l’Italie. Et ainsi de suite. Chaque pays pense qu’il économise, mais en réalité, tout le monde se met à payer de moins en moins - jusqu’à ce que le prix devienne inférieur au coût de production.
Une étude de 2019 a montré que les pays qui utilisent le PRI comme seul outil de fixation des prix voient des baisses de 22 % plus importantes que les autres - mais aussi des retards de 18 % pour l’arrivée de nouveaux génériques sur le marché. Pourquoi ? Parce que les entreprises attendent que les prix se stabilisent avant d’investir.
La solution : des groupes intelligents, pas juste des chiffres
Les experts comme le professeur Panos Kanavos de la London School of Economics ont montré que les systèmes les plus efficaces utilisent 5 à 7 pays de référence. En utiliser plus de 10 ne donne pas plus d’économies - mais augmente les risques de pénuries de 12 %.
La nouvelle approche, adoptée par la Commission européenne depuis 2023, vise à créer une « plateforme européenne de prix de référence ». Elle commence avec 15 médicaments, mais devrait couvrir 100 d’ici 2025. L’idée ? Coordonner les prix entre pays pour éviter la spirale, tout en tenant compte de la complexité du médicament. Par exemple, un générique pour une maladie rare pourrait avoir un groupe de référence différent d’un antibiotique courant.
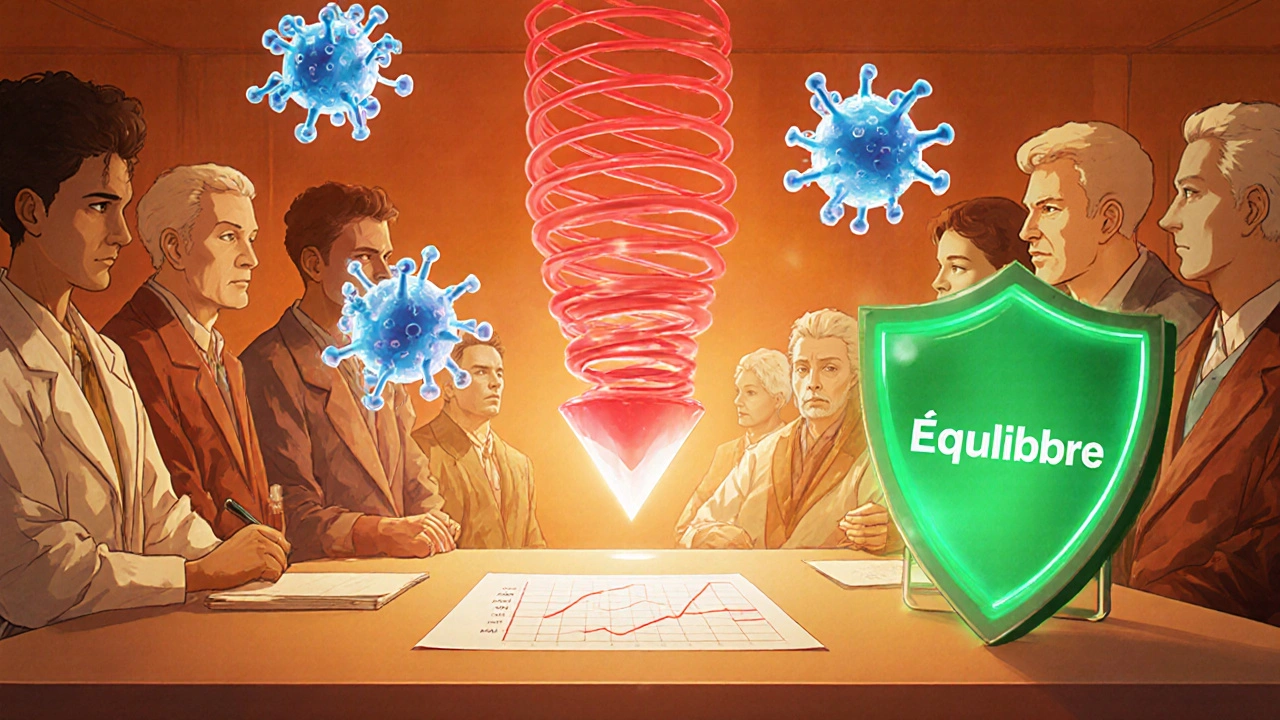
Que pensent les pharmaciens et les patients ?
Les pharmaciens espagnols disent que le PRI a rendu la substitution plus facile - mais qu’ils doivent souvent expliquer aux patients pourquoi certains génériques ne sont pas disponibles. Les patients, eux, sont globalement satisfaits : 78 % dans une enquête de l’OCDE trouvent que les génériques sont efficaces. Mais 34 % doutent de leur qualité, surtout quand ils changent de marque à chaque ordonnance.
Les gestionnaires d’hôpitaux en Allemagne confirment : le système réduit la paperasse, mais complique la gestion des équivalences thérapeutiques. Un patient qui prend un générique depuis un an peut se retrouver avec un autre, plus cher, parce que le premier a été retiré du groupe de référence.
Que va-t-il se passer dans les prochaines années ?
Les analystes d’IQVIA prévoient que d’ici 2027, 65 % des prix des génériques en Europe seront déterminés par le PRI - contre 58 % en 2022. Mais le modèle évolue. Il ne s’agit plus seulement de regarder les prix des voisins. Les pays commencent à intégrer des critères comme la qualité, la complexité de fabrication, et même la durabilité environnementale.
Le rapport de l’OCDE en 2023 recommande clairement : « Des groupes de référence différenciés selon l’importance thérapeutique ». Autrement dit, un générique pour le diabète ne devrait pas être traité comme un antalgique bon marché. Il faut des systèmes plus fins, plus intelligents.
Le Canada et les États-Unis : des modèles différents
Le Canada ne fixe pas les prix des génériques avec le PRI. Il laisse les provinces gérer les appels d’offres. C’est pourquoi un même médicament peut coûter deux fois plus cher dans une province qu’une autre. Aux États-Unis, le PRI est presque inexistant au niveau fédéral. Les prix sont négociés par les assureurs et les pharmacies. Résultat : des inégalités massives. Un patient peut payer 5 $ pour un générique dans un magasin de détail, et 50 $ dans un hôpital.
Ces modèles montrent une vérité simple : il n’y a pas de « bonne » façon de fixer les prix. Mais il y a des façons plus équilibrées - qui réduisent les coûts sans sacrifier l’accès, la qualité ou la stabilité du marché.
Que peut-on attendre à l’avenir ?
Le PRI pour les génériques ne va pas disparaître. Il va simplement devenir plus sophistiqué. Les pays vont s’adapter pour éviter les pénuries, encourager la production de génériques complexes, et garantir que les patients ne paient pas plus qu’ils ne doivent - mais aussi qu’ils reçoivent le bon médicament, au bon moment.
La clé ? Ne pas traiter tous les génériques comme identiques. Un antibiotique courant n’a pas le même impact qu’un traitement pour la sclérose en plaques. Et les systèmes de prix doivent le refléter.
Qu’est-ce que le prix de référence internationale (PRI) pour les génériques ?
Le prix de référence internationale est une méthode utilisée par les gouvernements pour fixer le prix de remboursement des médicaments génériques en se basant sur les prix pratiqués dans d’autres pays. Plutôt que de négocier chaque médicament individuellement, les autorités créent un « panier » de pays de référence (comme l’Allemagne, la France ou l’Italie), calculent la moyenne ou la médiane de leurs prix, et fixent le prix national à ce niveau. Cela permet de réduire les coûts pour les systèmes de santé.
Pourquoi certains génériques sont-ils plus chers dans certains pays ?
Cela dépend de la méthode utilisée pour fixer les prix. Les pays qui n’utilisent pas le PRI, comme les États-Unis, laissent les marchés libres ou les négociations entre assureurs et fabricants. Ceux qui l’utilisent, comme la plupart des pays européens, imposent des plafonds basés sur les prix étrangers. Un générique peut donc coûter 10 $ dans un pays avec PRI et 50 $ dans un pays sans. Ce n’est pas une question de qualité - c’est une question de politique.
Le PRI cause-t-il des pénuries de médicaments ?
Oui, quand il est mal appliqué. En Grèce et au Portugal, des prix fixés trop bas ont conduit à la disparition de certains génériques du marché parce que les fabricants ne pouvaient plus produire à ce prix. Lorsque le prix est inférieur au coût de production, les entreprises ferment les lignes de fabrication. C’est un risque réel, surtout pour les génériques à faible marge ou complexes.
Le PRI nuit-il à la qualité des génériques ?
Non, pas directement. Les génériques doivent respecter les mêmes normes de qualité que les médicaments d’origine. Mais quand les prix sont trop bas, les fabricants peuvent réduire les coûts en simplifiant les processus, en utilisant des matières premières moins chères, ou en sortant du marché des génériques complexes. Cela peut indirectement affecter la disponibilité de certains traitements, surtout pour les maladies rares.
Pourquoi le Canada ne utilise-t-il pas le PRI pour les génériques ?
Le Canada utilise le PRI seulement pour les médicaments brevetés, via son Office d’examen des prix des médicaments brevetés (PMPRB). Pour les génériques, chaque province gère ses propres appels d’offres. Cela donne plus de flexibilité, mais aussi des inégalités entre les provinces. Certaines obtiennent des prix très bas, d’autres non. Le PRI est évité pour les génériques car les systèmes provinciaux sont déjà assez efficaces pour contrôler les coûts.
Quels sont les pays qui utilisent le PRI de la manière la plus efficace ?
Les pays qui combinent le PRI avec d’autres outils - comme les appels d’offres, les remises obligatoires, et des groupes de référence bien conçus - sont les plus efficaces. Les Pays-Bas, l’Allemagne et la Suède sont souvent cités comme exemples. Ils utilisent 5 à 7 pays de référence, évitent les prix trop bas, et ajustent leurs systèmes en fonction de la complexité des médicaments. Leur taux de disponibilité des génériques dépasse 97 %, tout en réduisant les coûts de 28 % en moyenne.
Le PRI va-t-il disparaître à l’avenir ?
Non, au contraire. Il va évoluer. D’ici 2027, 65 % des prix des génériques en Europe seront déterminés par des systèmes de référence. Mais ils deviendront plus nuancés : des groupes de référence différents selon la maladie traitée, des prix ajustés en fonction de la complexité du médicament, et des mécanismes pour éviter les pénuries. Le PRI ne sera plus juste une question de prix - ce sera une question de stratégie de santé publique.


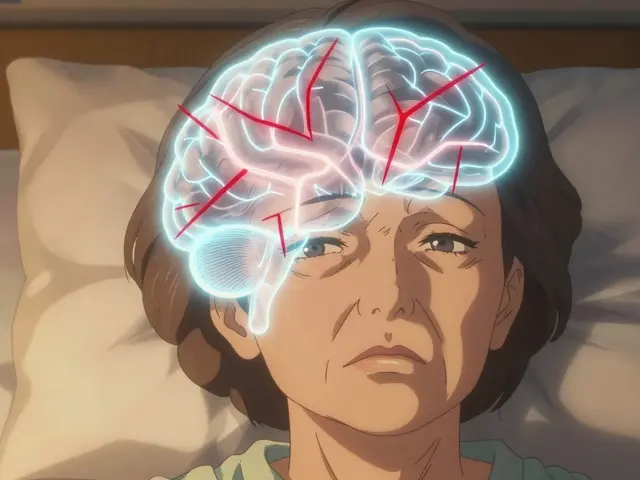


10 Commentaires
J'ai trouvé ça super intéressant, surtout la partie sur les pénuries. J'ai eu un ami qui a dû attendre 3 semaines pour son traitement, et c'était stressant./p>
Le PRI c'est pas magique mais c'est nécessaire. En France on a trop longtemps laissé les prix flotter. Maintenant on voit des résultats. Même si ça fait mal aux labos, c'est pour le bien commun./p>
Je suis d'accord avec James 😊 mais attention aux génériques pour maladies rares, c'est là que ça se casse la gueule. J'ai vu des gens se faire refuser leur traitement parce que le prix était 'trop bas'. C'est inhumain./p>
C'est n'importe quoi. Les gens veulent pas changer de médicament, c'est pas juste une question de prix./p>
Les Allemands ont raison : fixer le prix au plus bas, c'est la seule manière de contrôler la dérive des coûts. Toute autre approche est de la faiblesse morale et de la capitulation devant les lobbies pharmaceutiques./p>
Le PRI est une aberration bureaucratique ! Qui a décidé que 5 pays étaient suffisants ? Et pourquoi pas 7 ? Et pourquoi pas 12 ? Il faudrait un comité d'experts, avec un protocole ISO, des audits trimestriels, et une transparence absolue !/p>
Je trouve ça scandalisant qu'on traite les génériques comme des produits de supermarché. Un médicament, ce n'est pas une boîte de pâtes ! Et puis, qui a dit qu'on pouvait comparer la France à la Grèce ? C'est une insulte à la science !/p>
Dans mon pays on a pas ce systeme mais les gens paient moins et ont les medicaments. Parfois la solution est plus simple que de comparer les prix des autres pays/p>
La logique économique derrière le PRI est solide, mais l'application manque de nuance. La littérature académique montre que l'effet de spirale est amplifié par l'absence de mécanismes de feedback en temps réel. Une intégration des données de disponibilité locale dans le modèle de référence serait une avancée critique. Sans cela, on réduit les coûts au prix de la sécurité du patient./p>
On voit bien que les pays du Sud n'ont pas les mêmes priorités. En France, on ne peut pas permettre que des laboratoires étrangers dictent nos prix. Le PRI doit être un outil de souveraineté sanitaire, pas un outil de dépendance./p>